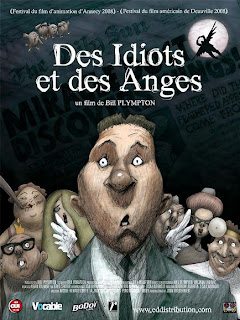Réalisateur du volet « Quartier Latin » dans Paris je t’aime, Frédéric Auburtin se place ici aux antipodes de ce court-métrage en offrant une comédie bien française, gags et scénario loufoque à l’appui.
Les deux Gérard (Lanvin et Jugnot) forment un duo de journaliste/technicien pour une grande radio française. Ils sont envoyés en reportage en Irak. Sauf que … Jugnot dit Poussin dans le film, dont la femme l’a trompé « par mégarde » avec Lanvin (Franck) sans savoir qu’ils étaient associés, jette l’enveloppe contenant les billets de leur vol pour Bagdad et les 20 000 euros en liquide, réserve à des fins de survie une fois sur place. Ils décident donc de tourner leur reportage depuis Barbès, chez Jimmy (Omar Sy).
Passé la petite histoire, en profondeur, on y trouve LE très beau monde des médias tourné en dérision, de mise pour un sujet sérieux comme celui d’une prise d’otage (inventée de toute pièce par le « duo de choc »). Cette position satyrique est tellement agréable à regarder : le cinéma qui met à mal la presse, les émissions larmoyantes profitant du filon « sensibilité du spectateur », la manipulation de l’information, etc.
Dans ce film, de belles surprises comme Omar Sy d’Omar et Fred dont la prestation en gérant de sauna homosexuel ou encore la reconversion réussie d’Anne Marivin, ex-Ch’ti (ouf ?). Les quelques séquences de guerre sont également pleine de réalisme et méritent d’être citées, ne serait-ce que parce que ces scènes ont du être les plus techniques du film.
Finalement, Jugnot est égal à lui-même, acteur de comédie ni bon ni mauvais. Lanvin est autant agaçant qu’attachant et le duo qui en résulte pallie le côté parfois plat du reste. Leurs réactions s’anticipent de manière trop prévisible, malgré un petit suspens (rare) et manquent de finesse pour des acteurs dont les carrières réciproques ne sont pas à leurs débuts…
Bilan global en demi-teinte : ce n’est ni le film de l’année, ni le navet tant attendu.
Claire Berthelemy